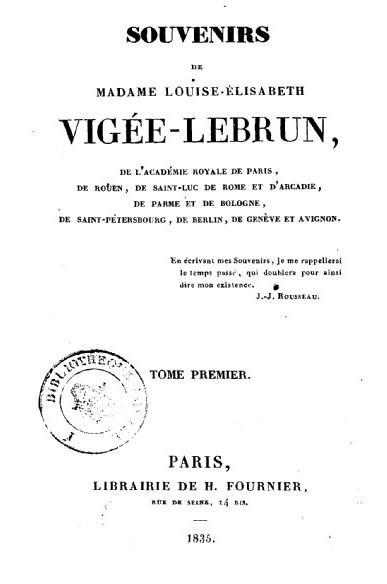Résumé
Portraitiste officielle de Marie-Antoinette, Élisabeth Vigée Le Brun émigre en octobre 1789, voyageant d’une cour à l’autre pendant près de vingt ans, de Rome à Saint-Pétersbourg, avant de séjourner en Angleterre. Artiste de la mondanité et de la mise en scène de soi et des autres, elle publie de 1835 à 1837 des Souvenirs où s’entrelacent chroniques de la vie des élites européennes et sociabilité artistique. Nous nous intéressons ici aux relations que Vigée Le Brun a entretenues avec de nombreux Anglais, outre-Manche et sur le continent, ainsi qu’au jugement sur les pratiques sociales britanniques qu’elle livre dans son autobiographie.
Mots-clés
Fille du peintre de pastels Louis Vigée, sœur aînée d’un littérateur ambitieux, Élisabeth Vigée Le Brun (1755-1842) est initiée à son art par un père aimant qui décède prématurément. Conseillée par Joseph Vernet, elle débute tôt une carrière de portraitiste placée sous le signe de la sociabilité mondaine, puisque la jeune et charmante peintre fait fureur à Paris avant même son mariage en 1776 à Jean-Baptiste Pierre Le Brun, artiste sans talent mais habile commerçant de tableaux et d’antiquités, qui encourage sa productivité. Malgré leur divorce en 1794, il reste au-delà des évènements révolutionnaires1 son fervent défenseur et un allié parfois ambigu en affaires. Cette union marque la première étape d’une ascension sociale exceptionnelle qui mène une femme issue du milieu artistique et bourgeois à fréquenter la reine de France et les plus grands du royaume.2 Au début des années 1780, période où la mode française continue à rimer avec nouveauté et élégance, mais où le désir de liberté et de sobriété s’accroît,3 les portraits que Vigée Le Brun réalise de Yolande de Polignac et de la souveraine contribuent à diffuser dans toute l’Europe la mode de la robe chemise en mousseline blanche.
- 1. Jean-Baptiste Le Brun, Précis historique de la vie de la citoyenne Lebrun (À Paris, chez l’auteur, An II.)
- 2. Voir Mary D. Sheriff, The Exceptional Woman. Elisabeth Vigée-Lebrun and the Cultural Politics of Art (Chicago and London: The Chicago University Press, 1996).
- 3. Portrait et mode s’influencent l’un l’autre. Voir À la mode. L’art de paraître au XVIIIe siècle, L’Objet d’art. Hors Série (Dijon: Éditions Faton, 2021).
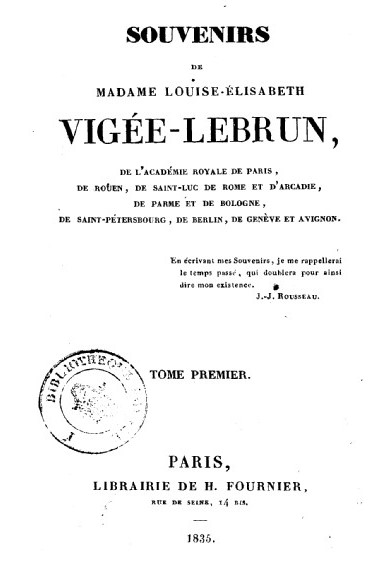
Source : Gallica BnF.
Source de calomnies diffusées dans des libelles révolutionnaires, son alliance avec la cour conduit la protégée de Marie-Antoinette et de la famille Polignac à fuir dès les prémices de la Révolution, puis à parcourir l’Europe, avant de rentrer définitivement dans son pays quelque seize ans plus tard. Ses Souvenirs,4 qu’elle fait paraître de 1835 à 1837, mêlent lettres, notices, relation de voyage et liste des peintures réalisées. Soucieuse de l’image qu’elle veut laisser à la postérité, elle y élabore un récit de vie dans lequel elle revient sur son parcours hors du commun, reconstruisant son existence de femme mondaine et d’artiste qui, accompagnée de sa fille Julie et armée de son seul pinceau pour assumer leur subsistance, sillonna l’Europe jusqu’en Russie. De 1789 à 1805, au cours de ses longues années d’exil, que ce soit à Londres même où elle vit non loin de trois ans tout en se rendant dans les maisons de campagne de l'aristocratie anglaise et dans les villes thermales, ou bien au cours de ses pérégrinations sur le continent, Élisabeth Vigée Le Brun croise le chemin de nombreux sujets de la couronne britannique qui lui fournissent l’occasion de brosser de saisissants portraits, en peinture ou en mots.
- 4. Elisabeth Vigée Le Brun, Souvenirs. 1755-1842, éd. Geneviève Haroche-Bouzinac (Paris: Classiques Champion, 2015). Les références à cet ouvrage sont indiquées entre parenthèses dans le corps du texte.
Alors qu’elle a fréquenté peu d’Anglais à Paris, ses contacts avec les ressortissants britanniques s’intensifient une fois franchies les Alpes. L’Italie est en effet pour ces derniers une destination très prisée. Dans la tradition du Grand Tour, les amateurs d’art et les artistes s’y installent, pour un temps plus ou moins long, dans les différentes capitales de la mosaïque d’États que constitue alors la péninsule. En outre, les Anglais, friands de portraits, genre dans lequel eux-mêmes excellent, prêtent une attention soutenue à l’une des très rares femmes à avoir été adoubées par l’Académie royale de peinture de Paris.
Fin 1789, lors de son premier séjour à Rome, Vigée Le Brun fréquente Angelica Kauffmann, peintre suisse très liée à l’Angleterre pour y être devenue une portraitiste prisée de la haute société et avoir compté parmi les membres fondateurs de la Royal Academy. Elle prend plaisir à lui rendre visite, à se montrer à l’opéra en sa compagnie, à se trouver placée lors de réceptions officielles aux côtés de celle qu’elle considère comme ‘une des gloires de notre sexe’ (Souvenirs, 358). À Rome, même si elle fréquente d’autres émigrés français, elle croise aussi nombre de ‘Grand Tourists’ et en peint certains (Anne Pitt, fille de Lord Camelfort, Hyacinthe Roland, future épouse de Lord Wellesley, et Lord Bristol). 'Les Anglais en villégiature à Rome constituent un vivier de clientèle'5 appréciable pour celle qui doit '[s]e refaire une fortune' (Souvenirs, 372). Exposant l’autoportrait qu’elle destine à l’Académie de Florence, elle prend plaisir à recevoir les nombreux visiteurs qui se pressent chaque matin dans son appartement et participent ainsi à asseoir sa notoriété en Italie.
- 5. Geneviève Haroche-Bouzinac, L. E. Vigée Le Brun. Histoire d’un regard (Paris : Flammarion, 2011), p. 215.
Ce sont toutefois les portraits d’une ressortissante de la couronne britannique réalisés à Naples, où elle séjourne six mois, qui confèrent à Vigée Le Brun un succès européen durable : ceux de la célèbre Emma Hart (née Lyon), dont l’ambassadeur d’Angleterre, Lord Hamilton, était éperdument épris.

Le jeune modèle, dont la plastique évoquait celle des statues de l’Antiquité grecque, avait déjà posé pour Romney, Reynolds ou Kauffmann. Non sans une certaine condescendance de classe, Vigée Le Brun juge la future Lady Hamilton vulgaire, inculte et médisante. Dans ses Souvenirs (rédigés et parus bien après la mort de la portraiturée), elle prétend6 l’avoir conseillée sur sa manière de se vêtir (à partir de tuniques blanches et en se coiffant d’un schall)7 et lui avoir appris à dramatiser ses apparitions (la jeune femme possédait le don, maintes fois relevé par ses contemporains, de pouvoir prendre toutes les attitudes, modifiant instantanément sa physionomie).8 Pratiquant le genre du portrait allégorique alors à la mode en Angleterre, Vigée Le Brun la représente d’abord en Bacchante (couchée, ou dansant avec un tambour), puis en Sibylle. Fort attachée à ce dernier tableau de 1792 qui est resté ‘un de [s]es ouvrages de prédilection’ (Souvenirs, 440) et qui existe aussi sous forme de copies, l’artiste ne cesse de l’exposer lors des étapes importantes du voyage qui devait encore la conduire à sillonner longuement l’Europe avant de le faire figurer en bonne place, à partir de 1805, dans son atelier parisien.9 La portraitiste d’Emma Hart est reçue dans les résidences napolitaines de Lord Hamilton, notamment dans celle dont la localisation permet d’observer les mouvements éruptifs du Vésuve. Elle est invitée à prendre part à différentes excursions qui lui font découvrir une lumière et une nature qui l’enchantent ou des fêtes populaires des plus pittoresques à ses yeux. À Naples toujours, pour protéger ses yeux du soleil aveuglant, l’élégante au goût simple et sûr lance la mode du port du voile vert auprès des Anglaises en villégiature (416). Puis, alors qu’elle se trouve à Turin dans l’intention de regagner la France, apprenant la nouvelle des massacres de septembre 1792 commis dans les prisons et assistant à l’arrivée précipitée de nouveaux émigrés, Vigée Le Brun prend la route vers l’est, séjournant successivement à Vienne, Berlin, puis Saint-Pétersbourg, où ses contacts avec les ressortissants de la couronne britannique se raréfient.
- 6. Ersy Contogouris rapporte un témoignage de Goethe daté de 1787 qui contredit les affirmations de Vigée Le Brun. Voir Ersy Contogouris, ‘Inspiration divine: “Lady Hamilton en sibylle” par E. Vigée-Le Brun’, RACAR: Revue d’art Canadienne (vol.35, n°2, 2010), p. 36.
- 7. Puisant dans son vestiaire d’artiste, Vigée Le Brun, lanceuse de mode, propose à ses modèles des costumes et accessoires que l’on peut retrouver dans certaines de ses toiles et qui caractérisent son style pictural. Voir À la mode…, op. cit., p. 7.
- 8. Voir, par exemple, Adèle de Boigne, Mémoires [1907], 4 vols (Paris : Mercure de France, 1971), rééd. 1999, vol. 1, pp. 122-123.
- 9. Elle s’en défait en 1819 seulement en le vendant au duc de Berry.
Rayée de la liste des émigrés en 1800, Vigée Le Brun rentre à Paris le 18 janvier 1802. Mais elle ne reconnaît pas la ville qu’elle aime, notamment en raison des changements intervenus dans les pratiques de sociabilité : les habits chatoyants des hommes ont cédé la place à des redingotes noires, les soupers ont quasiment disparu, les usages anglais sont en vigueur lors des soirées musicales où femmes et hommes se regroupent chacun de leur côté, et la cour napoléonienne, militarisée et constituée en bonne part de parvenus, lui semble manquer d’élégance et de finesse. L’artiste met donc au point le projet de découvrir outre-Manche un pays dont elle a rencontré et peint tant de voyageurs et d’expatriés au cours de ses années d’émigration. À la fin de l’été, un repas organisé pour ses confrères parisiens par le peintre d’histoire Benjamin West, alors président de la Royal Academy of Arts, lui fait rencontrer le peintre Joseph Farington10 (qui tombe aussitôt sous son charme), l’écrivaine et salonnière Helen Maria Williams (qui invite fréquemment son frère Étienne à déclamer ses vers), l’acteur John Kemble ainsi que des membres en vue de la noblesse anglaise attirés par les arts comme Lady Oxford. Ce déjeuner franco-anglais contribue à sa décision de quitter Paris où les commandes tardent alors à venir (Haroche-Bouzinac, 393-394).
- 10. Joseph Farington, The Farington Diary, ed. James Greig, 8 vols (London: Hutchinson and Co., 1923), vol. 2, p. 35.
Le 15 avril 1803, l’artiste embarque à Calais, sans connaître un mot d’anglais, mais accompagnée de sa fidèle servante Adélaïde. Le regard qu’elle va porter sur Londres, ville dont elle espère un regain de fortune au sens propre plus qu’au figuré, ne trahit pas un enthousiasme démesuré, loin s’en faut. En l’absence de musée de peinture (la National Gallery n’ouvre ses portes qu’en 1824), et malgré la richesse de l’abbaye de Westminster et de la cathédrale Saint-Paul, l’artiste et la curieuse en elle y trouvent bien moins de satisfactions qu’à Paris ou en Italie. Si la voyageuse apprécie la visite que lui rend l’actrice Sarah Siddons dont le jeu l’enthousiasme (Souvenirs, 662), les dimanches londoniens, s’afflige-t-elle, ‘sont aussi tristes que le climat’ (659). La fermeture dominicale des boutiques et l’absence ce même jour de spectacles, de bals et surtout de concerts, qu’elle prise plus que tout dans cette ville où l’on s’amuse comme elle s’y ennuie (ce sont ses propres mots), l’obligent à se réfugier dans des routs, ces assemblées de plusieurs centaines de personnes réunies chez un hôte ou une hôtesse qu’on ne peut pas approcher tant le logis est encombré. ‘Dans cette foule’, écrit-elle, ‘on est pressé, heurté continuellement, au point que cela devient une grande fatigue, et pourtant il n’y a rien pour s’asseoir’ (659). L’expérience est d’autant plus désagréable que, selon elle, personne n’y parle, pas plus que lors des promenades dans les parcs de la ville où les couples lui font l’effet d’‘ombres qui marchent’ (Ibid.).
Nostalgique des salons de l’Ancien Régime, la pétillante Vigée Le Brun - dont les soirées furent prisées (on pense à son fameux ‘souper grec’ de janvier 1788 ou au bal d’adieu qu’elle offre à Paris en mars 1803) -, ne peut donc trouver son compte dans ces événements mondains marqués par la retenue et où la conversation lui paraît souvent languissante. Mais il lui faut se constituer une clientèle, car la société des émigrés français réunie autour de la famille d’Orléans, du comte de Vaudreuil et du comte d’Artois ne saurait à elle seule faire vivre l’artiste. C’est donc lors des routs londoniens qu’elle fait la connaissance de celles qui ‘[lui] composèrent bientôt une société’ sans pourtant jamais lui commander leur portrait: Lady Hertford, Lady Monck, ou bien encore Georgiana Cavendish, duchesse de Devonshire, ‘[l]a femme de Londres la plus à la mode à cette époque’ (Souvenirs, 664). Dans sa biographie de Georgiana, Amanda Foreman rapporte comment la légère robe de mousseline « à la créole » dans laquelle Vigée Le Brun avait peint Marie-Antoinette en 1783 allait être introduite par l’élégante duchesse sur le sol anglais et y connaître un succès immédiat. Voir Amanda Foreman, Georgiana. Duchess of Devonshire (London: HarperCollins, 1999), p. 176. Désireuse d’entrer dans la danse des invitations, la voyageuse donne elle aussi des soirées (663), lors desquelles la musique joue une large part puisqu’elle y reçoit les deux premières cantatrices de l’Opéra, Elizabeth Billington et Giuseppina Grassini, ainsi que le célèbre violoniste Giovanni Battista Viotti tant apprécié à Paris qu’à Londres. Une brillante société se rend à ses concerts auxquels assiste même le Prince de Galles. C’est d’ailleurs aux faveurs de ce prince prodigue et inconstant, dont elle fait le portrait en 1803, qu’elle doit de pouvoir rester dans le royaume alors même que le traité d’Amiens vient d’être rompu. Ces mêmes faveurs suscitent aussi l’inimitié d’une frange de ses collègues anglais (Souvenirs, 668), moins sensibles à son talent que ne l’avait été le défunt Joshua Reynolds, qui s’était enthousiasmé pour son portrait du comte de Calonne lors de son passage aux douanes de Londres (661). Le pamphlet de son concurrent John Hoppner (publié en préface des Oriental Tales en 1805) la blesse d’autant plus qu’il lui reproche de transformer son atelier en ‘boutique’ de drapier, elle qui avait trouvé si détestable la coutume des peintres anglais de faire payer la visite de leur atelier par un pourboire en apparence destiné aux domestiques mais, de fait, vite empoché par leurs maîtres (661).

Dans le pays de George III, on ne reçoit pas qu’à Londres. C’est même souvent dans les ‘country houses’ qui ‘parsèment les belles campagnes de l’Angleterre’ (Souvenirs, 675) et en structurent le tissu social que se déploie la vie mondaine cultivée et brillante que Vigée Le Brun apprécie tant, comme à Gillwell autour de Margaret Chinnery (l’amie et la correspondante de Mme de Genlis dont elle fait le portrait12 ou à Benheim, chez l’excentrique margravine d’Anspach, Elizabeth Craven, née Berkeley. Fatiguée d’un brouillard londonien chargé de lourdes émanations de charbon qui ‘ternit l’imagination’ (Souvenirs, 679), l’artiste française ne manque pas une occasion d’aller prendre l’air dans la campagne anglaise et en profite pour visiter les collections d’œuvres d’art abritées dans les plus riches résidences, comme à Hampton Court, où elle admire les cartons de Raphaël, au château de Knowles, alors propriété de la duchesse de Dorset, à Stowe, chez les Buckingham, ou bien encore à Blenheim, chez les Marlborough, ainsi qu’à Warwick où elle retrouve avec une certaine contrariété deux des dessins qu’elle avait offerts à Lord Hamilton. Elle passe aussi un moment marqué par la cordialité et la simplicité chez l’astronome William Herschel, qui prend le temps de lui présenter des inventions (son fameux télescope), des découvertes (la planète Uranus) et des cartes (celle de la lune) qui la laissent enfin ‘sans un moment d’ennui’ (677).
- 12. The Unpublished Correspondence of Mme de Genlis and Margaret Chinnery, ed. Denise Yim (Oxford: Voltaire Foundation, SVEC, 2003).
Mais l’impression qu’elle retient de ses séjours dans les fameuses villes d’eaux d’Angleterre est bien différente : si elle admire les paysages autour de Matlock (Derbyshire) et de Tunbridge Wells (Kent), si elle déclare Brighton ‘une assez jolie ville’ (Souvenirs, 678) ou si elle trouve à Bath un aspect ‘noble et pittoresque’ (679), c’est à nouveau l’incompréhension des charmes de la sociabilité à l’anglaise qui colore ses propos. À Tunbridge Wells, ‘le soir on s’ennuie beaucoup dans les assemblées qui sont très nombreuses’ (678), écrit-elle à son frère, alors qu’elle lui dira de Bath : ‘Je suis restée trois semaines à Bath. On m’avait tant assuré que je m’y amuserais infiniment, que je m’attendais à trouver là les délices de Capoue. Il s’en est bien fallu vraiment’ (680). Vigée Le Brun réussit néanmoins à se constituer un cercle d’intimes comptant notamment Lady Bentinck, Mme Anderson et Lord Trimlestown, qu’elle quitte avec un certain regret (690) afin de retrouver sa fille enfin revenue à Paris. Si elle se rend une dernière fois à l’étranger lors des voyages en Suisse qu’elle effectue en 1807 et 1808 (où elle est notamment reçue par Germaine de Staël), ces séjours ne lui fournissent pas l’occasion de frayer à nouveau avec des sujets britanniques et elle ne retournera pas outre-Manche.
Lors de son exil, Élisabeth Vigée Le Brun retrouve pour partie, dans certaines cours européennes (à Vienne et Saint-Pétersbourg surtout), la sociabilité brillante des soirées françaises de l’Ancien Régime lors desquelles elle savait déployer des talents d’animatrice certains. Dans ses Souvenirs, les pratiques à ses yeux plus bourgeoises, protestantes et austères dont elle fait l’expérience en Angleterre n’en contrastent que davantage. En la matière, une de ses principales critiques concerne la différenciation vespérale entre activités masculines et féminines : ‘Après le dîner, on se réunissait dans une belle galerie, où les femmes sont à part, occupées à broder, à faire de la tapisserie, et sans dire un seul mot. De leur côté, les hommes prennent des livres et gardent le même silence’ (685). Cette ‘absence totale de conversation’ en soirée lui pèse d’autant plus que ‘causer avec agrément’ en Angleterre est tout à fait possible, ‘beaucoup d’Anglais [étant] fort spirituels’, et que son séjour - relativement lucratif - la conduit à démentir les préjugés répandus sur le manque d’hospitalité des habitants des îles britanniques (690).
Si elle ne semble pas s’être aussi durablement liée d’amitié avec des sujets de la couronne britannique qu’avec des ressortissants d’autres nations (on pense en particulier à la princesse Kourakine et à la comtesse Potocka qu’elle choisit comme destinataires des deux principales parties épistolaires de ses Souvenirs), Vigée Le Brun n’en reste pas moins fortement attachée au portrait de Lady Hamilton en Sibylle que, du Consulat à la Restauration, elle expose dans son atelier parisien, comme en témoignent plusieurs visiteurs étrangers13 parmi lesquels les Britanniques Bertie Greatheed14 en 1803 et Maria Edgeworth en 1820.15 Selon Ersy Contogouris, elle s’est approprié la portraiturée pour faire de son tableau un manifeste sur le génie féminin et s’y projeter dans une forme d’autoportrait oblique.16 Sous le Consulat, elle est après David l’artiste qui reçoit le plus grand nombre de visiteurs anglais,17 signe d’un lien de sociabilité avec le monde britannique perdurant par-delà son séjour.
- 13. Voir par exemple Johann Friedrich Reichardt, Un hiver à Paris sous le Consulat. 1802-1803 [Vertraute Briefe aus Paris], trad. Arthur Laquiante révisée par Charles Mehl, éd. Thierry Lentz (Paris: Taillandier, 2003), pp. 181-183.
- 14. An Englishman in Paris: 1803. The Journal of Bertie Greatheed, eds J.P.T. Bury and J.C. Barry (London, 1953), pp. 26-32.
- 15. ‘Maria Edgeworth to Mary and Charlotte Sneyd, 7 July 1820’, in Maria Edgeworth in France and Switzerland. Selections from the Edgeworth family letters, ed. by Christina Colvin (Oxford: Clarendon Press, 1979), p. 181.
- 16. Op. cit., pp. 41-43.
- 17. Voir Henri Fauville, La France de Bonaparte vue par les visiteurs anglais (Aix-en-Provence: Edisud, 1989).
Partager
Références complémentaires
Baillio, Joseph, and Salmon, Xavier (eds.), Élisabeth Louise Vigée Le Brun (Paris : Réunion des Musées Nationaux/Grand Palais, 2015).
Contogouris, Ersy, Emma Hamilton and Late Eighteenth-Century European Art: Agency, Performance and Representation (New York/London: Routledge, 2018).
Fumaroli, Marc, Mundus Muliebris. Élisabeth Louise Vigée Le Brun, peintre de l’Ancien Régime féminin(Paris : Éditions de Fallois, 2015).
May, Gita, Élisabeth Vigée Le Brun. The Odyssey of an Artist in an Age of Revolution (New Haven & London: Yale University Press, 2004).
Pitt-Rivers, Françoise, Madame Vigée Le Brun (Paris : Gallimard, 2001).
Sheriff, Mary D., ‘Portrait de l’artiste en historienne de l’art : à propos des Souvenirs de Mme Vigée-Lebrun’, in Mechthild Fend, Melyssa Hyde and Anne Lafont (eds.), Plumes et pinceaux : discours de femmes sur l’art en Europe (1750-1850). Essais (Paris : Publications de l’Institut National d’Histoire de l’Art, 2012).